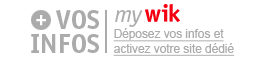Abdellah Taïa, entretien
Une mélancolie arabe, Le Jour du Roi (Prix de Flore 2010), Infidèles, Un pays pour mourir… Abdellah Taïa a bousculé la littérature du Maghreb avec des romans miroirs de l’actualité où il évoque clairement son homosexualité, les exclus… Avec La vie lente paru en 2019, il traite du changement de regard sur l’immigré en France après les attentats. Il prend place parmi les voix du monde invitées du festival Atlantide.
"
Je ne suis tendre avec personne. Même pas avec moi-même. "
Comment définissez-vous votre littérature ?
J’aime rappeler que j’écris en français, dans une langue qui n’est pas la mienne. Il m’a fallu beaucoup d’années pour la maîtriser. Ma littérature part d’un matériau vrai, réel, autobiographique mais dans un grand combat avec la langue.
-
Mais pourquoi écrire en français ?
Ça remonte aux origines sociales. Je suis né en 1973 dans une famille pauvre et nombreuse. Dans ce Maroc post-colonial, le français était une langue de pouvoir, chic, qui permettait de s’élever socialement. J’ai dû comprendre que ça m’élèverait. Je suis venu à la langue française pour manger…
-
N’est-ce pas écrire dans une langue un peu étrangère ?
Non. Je ne suis jamais venu à la langue française avec l’idée que c’était plus grand et plus fort que moi, que c’était plus important que les chants de ma mère ou l’imaginaire des pauvres Marocains. Ça ne m’a jamais déraciné. Le Maroc dans lequel je suis né et où j’ai grandi, c’est ce qui est sorti dans mon rapport à la langue française.
-
Vos romans parlent des exclus… Les homos, les immigrés, les pauvres…
On ne se dit pas “je vais donner la parole aux opprimés”. Mais ma vie est entrée là-dedans et je fais partie des minorités. L’identité gay, tellement loin d’un pauvre Marocain, n’était pas dans ma tête mais elle a dû aiguiser mon regard. Je me raccrochais à mon monde même s’il était synonyme de violence. J’ai l’impression que ma mère, mes sœurs et ma tante sont entrées en écriture avec moi.
-
Quel rapport entretenez-vous avec votre pays ?
Quand tout allait s’éloigner avec la mort de ma mère, le Maroc est revenu comme un tsunami qui continue de me dépasser. J’ai compris que je n’aurai jamais la réparation que je mérite pour la violence et les viols que j’ai subis. Il me faut tourner la page et pardonner. Mais ça ne veut pas dire que j’oublie.
-
La question de l’homosexualité est très présente dans votre œuvre, est-ce qu’elle vous stigmatise ?
Jamais car je suis sorti de la honte à douze ans. C’est là que j’ai commencé à réfléchir à comment j’allais manger et envahir le monde. Si certains veulent me réduire à un écrivain homosexuel, c’est qu’ils sont homophobes tout en se croyant tolérants. L’homosexualité n’est pas une petite chose pour moi et je ne vais pas revenir à la honte.
-
Vos romans regorgent de personnalités fortes, quelque chose de la Méditerranée au sens large…
J’appartiens à ce monde méditerranéen. Mon manque de pudeur, ma capacité de crier et d’être sauvage, de n’être pas bien civilisé à l’occidentale, ça n’est pas réfléchi. Je suis dans une autre logique de vie. Ma mère n’était pas soumise. Si soumission il y a, c’est aux yeux du pouvoir, politique ou religieux.
-
Vos phrases sont de plus en plus courtes, comme si votre écriture s’accélérait…
Plus j’écris, plus je me débarrasse d’une bonne écriture littéraire à la française. J’ai envie de revenir au dénuement. La mère qui n’a pas de quoi nourrir ses enfants, elle invente une histoire lorsqu’elle arrive chez le marchand de légumes. J’ai l’impression que ma littérature, elle en est là. À partir d’Infidèles, la cadence s’est accélérée parce que la mère est partie dans la mort. Il y a une colère immense par rapport à l’existence même. Tout dérape et s’accélère pour aboutir à une forme d’explosion.
-
Où commence la fiction ?
La fiction commence dans nos vies avant d’écrire. Notre regard transforme la réalité. Je ne veux pas raconter une fiction pure. J’ai l’arrogance de penser que j’ai trop d’histoires intéressantes en moi. Je vais vers la vérité des personnages mais je n’hésite pas à faire le menteur, le charmeur, le sadique.
-
C’est aussi une écriture politique…
Ça l’est devenu. J’ai moins peur du monde d’une manière politique. J’ai la capacité de nommer les choses. Dans La vie lente, le lien n’est pas la politique de la France mais elle entre au milieu de ce qui unit les personnages.
-
Vous mettez la France face à ses contradictions. Vous n’êtes pas très tendre avec elle…
Je ne suis tendre avec personne. Même pas avec moi-même. Il y a une forme de colère dans mon écriture. Mes livres se situent à un moment où quelque chose tombe. J’ai conscience de ce que vivent les immigrés, homos ou hétéros, et si je sens que quelque chose tombe en France, il me faut le raconter. Mais je ne fais pas de la socio expliquée.
-
Que lisez-vous en ce moment ?
Je suis dans un livre qui réunit les interviews de Fassbinder. Dans la société allemande d’après-guerre, il a osé dire la vérité au monde. Ça m’aide à sortir d’une phase de déprime. Ça parle de la fausse émancipation que le monde nous offre. Nous voulons que les droits arrivent, le changement pour les femmes mais ça ne doit pas être qu’un discours médiatique. Il faut aller au-delà de ce qui fait le buzz.
-
La rencontre entre le monde arabe et l’Occident est-elle possible ?
Oui parce que nous sommes tous des êtres humains. Mais l’Occident vit dans l’innocence de son arrogance. Il oublie qu’il a exploité le Sud. Le colonialisme s’est arrêté mais la France continue de faire comme si elle n’acceptait pas. Je crois qu’il est important que quelqu’un comme moi fasse le lien entre l’histoire et le colonialisme, l’homosexualité et le colonialisme…
-
Qu’attendez-vous des échanges avec les autres écrivains à Atlantide ?
Je suis ouvert d’esprit et j’ai besoin d’être secoué par les idées des autres. C’est un plaisir d’essayer de créer un échange car je ne veux pas rester figé dans ce que je pense du monde.
Interview Patrick Thibault
Crédit photos : Taïa © Abderrahim Annag